|

 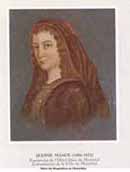 En
mai 1642, Jeanne Mance, Paul de Chomedey et un groupe de colons abordent
dans l'île de Montréal. Ils bâtissent un fort et Jeanne Mance y établit un
dispensaire qu'on appellera le « petit hôpital ». En
mai 1642, Jeanne Mance, Paul de Chomedey et un groupe de colons abordent
dans l'île de Montréal. Ils bâtissent un fort et Jeanne Mance y établit un
dispensaire qu'on appellera le « petit hôpital ».
Jeanne Mance quitte la France avec Paul de Chomedey et une
quarantaine de colons pour fonder Montréal; elle y établira un hôpital. À
Langres, sa ville natale, Jeanne Mance avait soigné des blessés de la
guerre de Trente Ans (1618-1648) et des malades atteints de la
peste. Forte de ses expériences comme infirmière, elle dirige le
dispensaire installé dans le fort.
Quelques années après l'établissement du dispensaire (petit
hôpital) dans le fort de Ville-Marie, on construit en 1645, en dehors
du fort, un bâtiment de pierre considéré comme le premier véritable
hôpital. Il sera situé à l'angle des rues Saint-Joseph (aujourd'hui
Saint-Sulpice) et Saint-Paul.
En 1694, on termine la construction d'un nouvel Hôtel-Dieu,
beaucoup plus imposant que le précédent. Malheureusement, trois mois plus
tard, il sera détruit par un incendie.
Le mot Hôtel-Dieu vient de l’époque médiévale. Un Hôtel-Dieu
était situés en général à l'ombre de la cathédrale et dépendant de
l'autorité de l'évêque, les premiers Hôtels-Dieu font leur apparition en
France au VIIe siècle. Il semble qu'au départ ils servent à héberger les
pèlerins et à évangéliser les voyageurs mais, petit-à-petit, cette fonction
hospitalière se transforme d'une part en hospice et d'autre part en hôpital
accueillant principalement les vieillards, les malades et les nécessiteux.
Ils seront de redoutables foyers de contagion au beau milieu des villes
lors des épidémies.
Pendant 17 ans, Jeanne Mance assume seule la tâche
d'infirmière à l'hôpital, assistée d'une servante. Lors de son second
voyage, elle ramène de France, en 1659, les trois premières Hospitalières :
soeurs Judith Moreau de Brésoles, Catherine Macé et Marie Maillet.
Ensemble, elles se consacreront aux soins physiques, mais aussi spirituels
des malades. En 1676, trois ans après le décès de Jeanne Mance, les
Hospitalières deviendront les nouvelles administratrices de l'Hôtel-Dieu.
Hospitalières de Saint-Joseph
Cette communauté religieuse est fondée en 1636, à La Flèche, en France, par
Jérôme Le Royer de La Dauversière et Marie de la Ferre. Elle a pour mission
le soin des malades.
À l'Hôtel-Dieu de Montréal, Jeanne Mance et les
Hospitalières prodiguent avec dévouement et compassion leurs soins aux
malades. Soeurs soignantes et apothicairesses accompagnent et soignent
gratuitement tous ceux qui leur sont confiés. Leur charité demeure
universelle.
Le 19e siècle fut celui des découvertes scientifiques. En
médecine, on assiste à une véritable révolution. L'avènement de
l'anesthésie, de l'asepsie, de la synthèse chimique de médicaments et de la
vaccination ainsi que l'invention de nouveaux instruments donnent à la
médecine un nouvel essor.
En 1860, Pasteur découvre les micro-organismes responsables
des infections et de la contagion. Lister propose l'antisepsie et ouvre
ainsi la voie à la découverte de l'asepsie. Pasteur découvre l'asepsie qui
a pour but de supprimer les microbes, véritable révolution dans le monde
chirurgical. Il invente le premier vaccin contre la rage. La vaccination se
généralise.
En 1901, les Hospitalières de Saint-Joseph fondent l'École
des infirmières de l'Hôtel-Dieu de Montréal. Formées scientifiquement et
orientées vers le don de soi, de jeunes femmes laïques se joignent à
l'équipe de soins. C'est la naissance d'une profession.
Aides-infirmières
Après la Première Guerre mondiale et, de manière plus aiguë, après la
Seconde Guerre, un besoin urgent de personnel se fait sentir dans les
hôpitaux du pays. Dès les années 20, ceux-ci ont pris l’habitude de
recruter du personnel peu qualifié, possédant une formation de quelques
semaines, voire quelques heures pour prendre la relève des infirmières dans
l’exécution de certaines tâches exigeant peu de qualifications. Les soins
de chevet, la distribution des repas, l’entretien de la chambre, etc.
constituaient l’essentiel des fonctions exigées des « aides-infirmières ».
Au Canada comme au Québec, le domaine des soins infirmiers
repose alors sur les épaules de personnel féminin, religieuses et
infirmières laïques. Cependant, le recours à du personnel de soutien n’est
pas systématique à cette époque et la formation des infirmières auxiliaires
ne relève que d’initiatives isolées. Une école d’infirmières auxiliaires
anglophones est mise sur pied dans les années 20 par une infirmière nommée
Miss Parker. Elle offre un cours d’une durée de neuf mois, divisé en deux
volets, l’un pratique et l’autre théorique.
Ce n’est qu’au début des années 40 que l’Association des
infirmières canadiennes (AIC) commence à se pencher sur la question
des infirmières auxiliaires. L’AIC reconnaît la nécessité de libérer
l’infirmière d’une partie de son travail pour la confier à une aide formée
à cet effet. Cependant, cette décision ne sera mise en œuvre qu’après la
Seconde Guerre mondiale (1939-1945).
Au lendemain de la guerre, le ministère du Bien-Être social
et de la santé du Canada effectue une enquête sur les besoins en personnel
dans le milieu hospitalier. Les hôpitaux souhaitent conserver les «
aides-infirmières » tout en leur donnant accès à une formation plus
poussée. Le ministère recommande ainsi la mise sur pied d’une structure
permettant la formation des infirmières auxiliaires à travers le Canada,
par la création d’un cours de 12 mois.
Pionnière de la profession : La première école de
gardes-malades auxiliaires au Québec
La première école de gardes-malades auxiliaires au Québec est inaugurée en
septembre 1950 par Charlotte Tassé. Mme Tassé est née le 2 mai 1897 à
Henryville, dans le comté d’Iberville au Québec. Cette infirmière
passionnée a consacré sa vie à sa profession. Elle a permis à des milliers
de jeunes aides-infirmières d’acquérir un statut professionnel et une
reconnaissance sociale. Elle a ainsi donné naissance à la profession
d’infirmière auxiliaire.
Mme Tassé a tout d’abord grandi dans une famille presque
entièrement dédiée à la santé : son grand-père était médecin, ses trois
sœurs sont devenues infirmières et l’un de ses cinq frères est également
devenu médecin. Après des études chez les religieuses de la Présentation de
Marie, elle obtient un diplôme d’infirmière de l’Hôpital Notre-Dame en
1917. Elle suit ensuite des cours de perfectionnement en pratique privée
durant six mois à l’hôpital Bellevue de New York, « J’avais à ce moment-là
l’idée que je ferais une carrière de ma vie d’infirmière. » Le 17 septembre
1919, à l’âge d’à peine 25 ans, elle est embauchée au Sanatorium Prévost
qui fermera ses portes en 1947, en raison de la défection des jeunes
recrues.
 Avec
en poche un certificat d’infirmière licenciée de l’Association des
infirmières du Québec, attribué en 1920, elle travaille au Sanatorium
Prévost tout en prenant une part active dans les congrès internationaux
d’infirmières au Québec et en Europe. En 1928, elle met sur pied, en
collaboration avec sa sœur Rachel, la revue La garde-malade
canadienne-française, qui deviendra plus tard Les cahiers du nursing
canadien. En coopération avec Bernadette Lépine, elle fait l’acquisition, en
octobre 1945, du Sanatorium Prévost duquel elle devient la directrice
générale. Elle y introduit en 1948 un cours de perfectionnement en soins
infirmiers psychiatriques. Le 4 septembre 1950, Charlotte Tassé réalise un
rêve de longue date en installant, dans le Sanatorium Prévost, la première
École de gardes-malades auxiliaires de la province de Québec. L’infirmière
Tassé devient une ressource incontournable pour les autorités, faisant
progresser de façon admirable la profession d’infirmière auxiliaire. Avec
en poche un certificat d’infirmière licenciée de l’Association des
infirmières du Québec, attribué en 1920, elle travaille au Sanatorium
Prévost tout en prenant une part active dans les congrès internationaux
d’infirmières au Québec et en Europe. En 1928, elle met sur pied, en
collaboration avec sa sœur Rachel, la revue La garde-malade
canadienne-française, qui deviendra plus tard Les cahiers du nursing
canadien. En coopération avec Bernadette Lépine, elle fait l’acquisition, en
octobre 1945, du Sanatorium Prévost duquel elle devient la directrice
générale. Elle y introduit en 1948 un cours de perfectionnement en soins
infirmiers psychiatriques. Le 4 septembre 1950, Charlotte Tassé réalise un
rêve de longue date en installant, dans le Sanatorium Prévost, la première
École de gardes-malades auxiliaires de la province de Québec. L’infirmière
Tassé devient une ressource incontournable pour les autorités, faisant
progresser de façon admirable la profession d’infirmière auxiliaire.
Lors de la Révolution tranquille (1964), elle quitte
contre son gré le poste de présidente du Conseil d’administration qu’elle
occupait. Elle a vécu une vie exemplaire au service des malades, de
l’enseignement et de la défense des intérêts des infirmières et des
infirmières auxiliaires. Elle s’est éteinte en 1974 à l’Hôtel-Dieu de
Montréal.
La formation des infirmières auxiliaires durant les années
50
Pour être acceptées au programme d’études de gardes-malades auxiliaire, les
étudiants doivent posséder un certificat d’études complémentaires de
neuvième année et être âgées de 18 à 30 ans. Afin d’obtenir leur diplôme de
gardes-malades auxiliaire, selon les exigences de Charlotte Tassé, les
étudiants doivent suivre un cours de 18 mois, incluant des cours théoriques
et six mois de stages pratiques à l’hôpital, complétés après leur scolarité
afin d’obtenir leur droit de pratique. Pendant toute la d urée du cours,
les élèves gardes-malades auxiliaires demeurent habituellement à l’hôpital
afin d’être en contact avec les malades. Cette pratique est favorisée par
le Comité des hôpitaux. Toutefois, chez les auxiliaires en nursing,
l’internat n’existe pas. Les étudiantes doivent loger à l’extérieur de
l’école et ne s’y rendre que pendant les heures de cours ou de travail pratique.
Durant les années 50, la formation des infirmières
auxiliaires s’apparente, à certains niveaux, à celle dispensée aux
infirmières à la même époque. Cette similitude ne résiste pas tant dans le
contenu de cours, mais dans le mode de travail imposé aux élèves. En effet,
le travail pratique occupe une place fondamentale dans les écoles
d’hôpitaux. Très peu d’heures sont consacrées à l’enseignement théorique et
la majorité du temps est employée à l’apprentissage des soins et des
techniques de nursing. Les étudiantes infirmières auxiliaires, qui
travaillent environ 54 heures par semaine, constituent pour les hôpitaux
une main-d’œuvre à bon marché, tout comme les élèves infirmières. Elles ne
reçoivent de fait qu’une faible rémunération en échange de leur travail,
soit environ 15 $ par mois.
Les techniques assimilées par les étudiantes infirmières
auxiliaires sont essentiellement reliées aux soins de chevet. Les soins
infirmiers proprement dits, soient la pathologie et les techniques, les soins
aux enfants, aux accouchées, etc., constituent 50 % du temps
d’enseignement. Par ailleurs, le programme d’études consacre 38 % du temps
de formation aux sciences humaines, religieuses et domestiques. Les
sciences biologiques, qui permettent de comprendre le fonctionnement du
corps humain et l’origine des maladies, n’occupent que 12 % du temps alloué
à la formation.
Le regroupement des infirmières auxiliaires
 Les
deux groupes d’infirmières auxiliaires (les gardes-malades auxiliaires
et les auxiliaires en nursing) se développent durant deux décennies,
mettant de l’avant leurs propres critères de formation et créant leur
propre association professionnelle. C’est cependant du côté des
gardes-malades auxiliaires que la lutte pour la reconnaissance professionnelle
se fera la plus vive. Elles jouissent d’un statut plus favorable que leurs
consoeurs, qui dépendent directement des infirmières par l’entremise de
l’AIPQ. Le nombre d’écoles de gardes-malades auxiliaires s’accroît donc
rapidement. En 1958, dix écoles dispensaient la formation de gardes-malades
auxiliaires au Québec. À la suite de l’admission des candidats masculins à
la profession, décrétées en 1964, le nombre d’écoles se multiplient :
lorsque le ministère de la Santé prend à sa charge la formation des
infirmières auxiliaires en 1968, 48 écoles de ce type existent déjà. Les
deux groupes d’infirmières auxiliaires (les gardes-malades auxiliaires
et les auxiliaires en nursing) se développent durant deux décennies,
mettant de l’avant leurs propres critères de formation et créant leur
propre association professionnelle. C’est cependant du côté des
gardes-malades auxiliaires que la lutte pour la reconnaissance professionnelle
se fera la plus vive. Elles jouissent d’un statut plus favorable que leurs
consoeurs, qui dépendent directement des infirmières par l’entremise de
l’AIPQ. Le nombre d’écoles de gardes-malades auxiliaires s’accroît donc
rapidement. En 1958, dix écoles dispensaient la formation de gardes-malades
auxiliaires au Québec. À la suite de l’admission des candidats masculins à
la profession, décrétées en 1964, le nombre d’écoles se multiplient :
lorsque le ministère de la Santé prend à sa charge la formation des
infirmières auxiliaires en 1968, 48 écoles de ce type existent déjà.
En 1971, les deux groupes d’infirmières auxiliaires
s’unissent finalement pour tenter d’obtenir de l’État la formation d’une
corporation professionnelle, telle que définie par le rapport de la
Commission d’enquête sur la santé et le bien-être social. Les infirmières
auxiliaires se fixeront alors pour but d’acquérir le même statut que celui
des infirmières. Les infirmières auxiliaires du Québec atteignent leur
objectif en 1974, lorsqu’elles se regroupent sous la bannière de la
Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du
Québec, appelée depuis 1994 l’Ordre des infirmières et infirmiers
auxiliaires du Québec (O.I.I.A.Q.).
Un programme de formation spécialisée
Depuis 1968 le ministère de l’Éducation à pour mandat de s’assurer du
programme S.A.S.I. (Santé, Assistance et Soins Infirmiers). La
formation conduisant à l’exercice de la profession d’infirmière auxiliaire
est d’une durée totale de 1 800 heures. Cette formation mène à l’obtention
d’un diplôme d’études professionnelles (DEP) décerné par le
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec.
En juin 2002, le gouvernement a modifié la législation
professionnelle dans le domaine de la santé et a accru considérablement le
rôle de l’infirmière auxiliaire. En plus des soins qu’elle était déjà
habilitée à dispenser, l’infirmière auxiliaire peut notamment effectuer des
prélèvements sanguins, administrer des vaccins sous ordonnance et
contribuer aux campagnes de vaccination découlant de l’application de la
loi sur la santé publique.
|